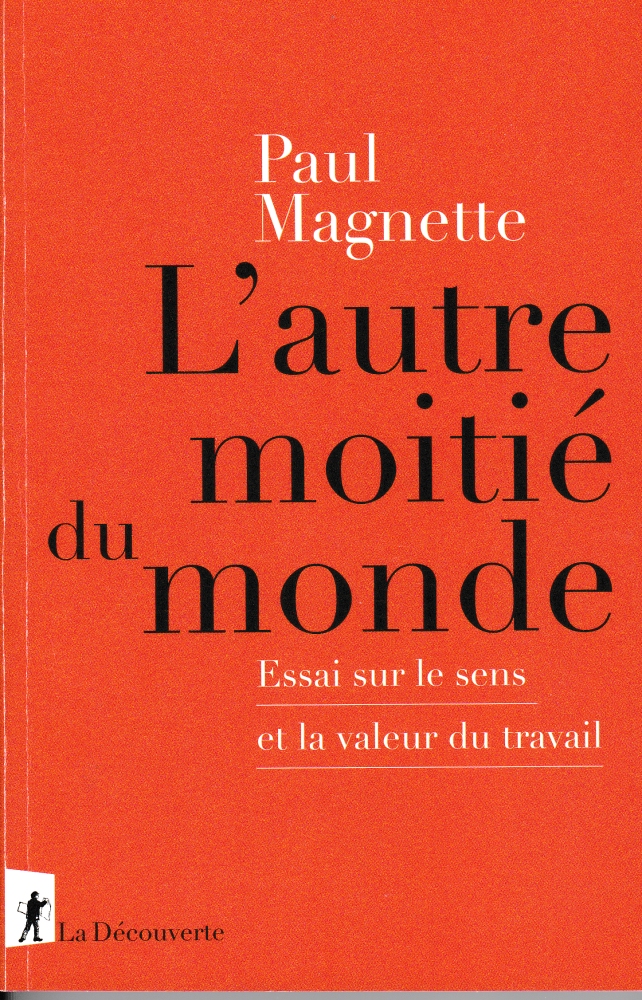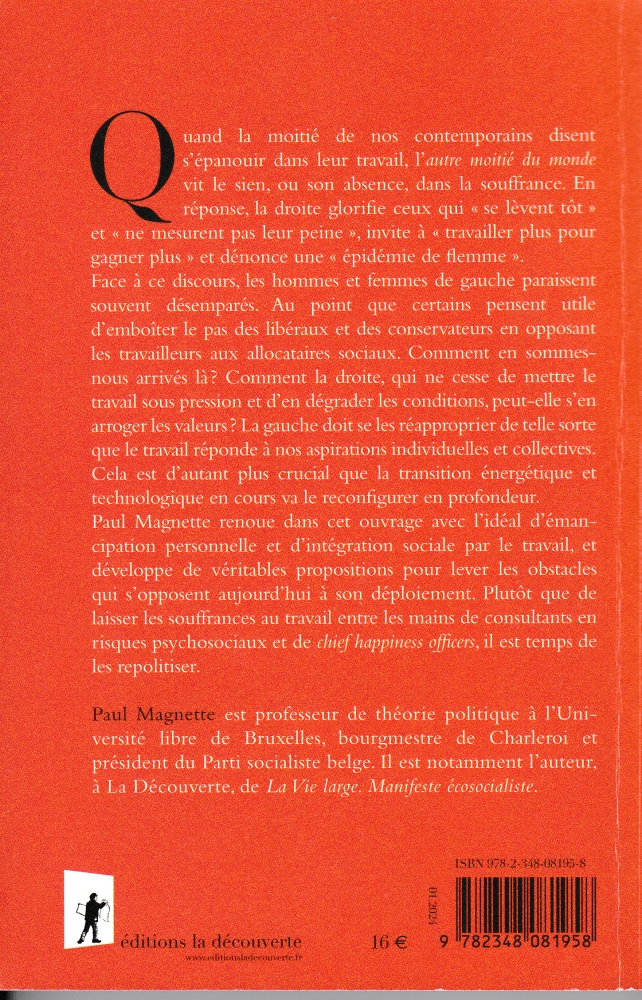Le “Travail” comme composante d'une vraie humanité
Mai 2024
Le “travail” comme expression et comme caractéristique d'une vraie personne humaine reste la pierre d'angle de la personnalisation qui fait l'humain. Après Simone Weil, La condition ouvrière (1951) et Hannah Arendt, Condition de l'homme moderne (2012), Paul Magnette nous présente un état de la question.
Paul Magnette, L'autre moitié du monde. Essai sur le sens et la valeur du travail, La découverte, Janvier 2024, 172/180 pp., ISBN 978-2-348- 08195-8
Voici un petit livre qui se lit facilement et fait une bonne synthèse historique de la place du travail humain dans le développement de nos sociétés “occidentales” depuis l'avènement de l'industrialisation et de la socialisation qu'elle a engendré – ainsi que du nouvel esclavage en cours de développement et qui est lié à l'extension des technologies depuis Les Temps Modernes de Charlie Chaplin jusqu'aux accélérations planétaires du 21e siècle!
Source et inspiration du travail
Les sources de Paul Magnette
Élu depuis plus de quinze ans sur des terres où l'industrie brillait naguère de mille feux, et qui continuent de subir dans leur chair les conséquences de la mondialisation et de la financiarisation de l'économie, je côtoie les travailleurs du service public local, je reçois les salariés des entreprises en restructuration, j'entends les témoignages d'ouvriers et d'employés lors de visites d'entreprises, je dialogue avec les organisations syndicales. …[Au courant de toutes les statistiques et études en cours dans ce domaine Paul Magnette peut confirmer] que la moitié des travailleurs sont satisfaits de leur travail et y accordent une très grande importance.
Le troisième fil déploie la réflexion d'une femme, une philosophe …qui fit le choix de s'établir en usine pour vivre le travail dans sa chair et dans son âme. Simone Weil… (pp. 13-14)
Et, dans l'histoire de la réflexion sur le travail, l'Auteur pointe quelques étapes importantes comme
L'Encyclopédie de Diderot: “ignorant les hiérarchies traditionnelles des métiers, elle range par ordre alphabétique – ce qui vaut au “roi” de se retrouver entre le “rimailleur” et le “rôtisseur” . Le travail n'est plus une malédiction ou une pénitence, il accède à la dignité des fonctions humaines fondamentales”. (p. 19)
Si Adam Smith jette “les bases de la théorie libérale de l'économie et de la société” (1776), il pressent les déviations possibles d'une rationalisation du travail
L'intelligence de la plupart des hommes se forme nécessairement par leurs occupations ordinaires. Un homme qui passe toute sa vie à accomplir un petit nombre d'opérations simples, dont les effets sont aussi peut-être toujours les mêmes ou très approchant les mêmes, n'a pas lieu de développer son intelligence ni d'exercer son imagination à chercher des expédients pour écarter les difficultés qui ne se rencontrent jamais; il perd donc naturellement l'habitude de déployer et d'exercer ses facultés et devient, en général, aussi stupide et aussi ignorant qu'il soit possible à une créature de le devenir” citation de Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, livre 5, Chapitre 1. (p. 19)
Quant à Karl Marx il observe que
L'araignée qui tisse sa toile et l'abeille qui construit sa cellule obéissent à des inclinations naturelles. L'architecte, lui, “construit la cellule dans sa tête” avant de lui donner forme dans la matière. Alors que 'l'animal se confond immédiatement avec son activité vitale', l'être humain 'fait de son activité vitale elle-même l'objet de sa volonté et de sa conscience' (Karl Marx, Manuscrits de 1844). Le travail, en somme, révèle l'essence de l'homme. (p. 25)
Et quant à l'apport de Simone Weil et d'Anna Ahrendt, on peut en retenir notamment
L'épreuve du travail est la source de l'intelligence et de l'habileté, de la volonté et de l'autonomie, du sens moral et esthétique. […] La peine et l'effort ne sont pas “des symptômes que l'on peut faire disparaître sans changer la vie; ce sont plutôt les modalités d’expression de la vie elle-même”… Le bonheur ne se réalise que “dans l'équilibre parfait des processus vitaux de l'épuisement et de la régénération, de la peine et du soulagement”. (pp.26-27). […] Le travail peut être compris comme le processus à travers lequel la souffrance se transforme en plaisir, l'impuissance en maîtrise. (p. 28).
L'évolution du travail confronté à une robotisation et à de nouvelles formes d'esclavage
On frissonne de plaisir à l'idée de confier les tâches pénibles et lassantes à des robots intelligents mais dociles, nous laissant le loisir de vivre la vie voluptueuse des patriciens antiques. Mais on frémit en imaginant qu'ils détruisent nos emplois, nous privant du même coup de nos revenus, de notre statut et de notre raison d'être. L'ambivalence de ces réactions reflète celle de notre rapport au travail, et révèle sa place centrale dans nos existences. (p. 31)
Et les conséquences d'un tel décrochage du travail
On estime que les pathologies liées au chômage (dépressions, maladies chroniques, assuétudes, etc…) causent en France quatre fois plus de morts que les accidents de la route. Ce chiffre terrible dit mieux que de longs discours combien le travail demeure la colonne vertébrale de nos existences, et le ciment de la vie sociale. (p. 44)
Très tôt, et assez ironiquement, par un proche du grand pourfendeur de l'esclavagisme industriel, Karl Marx, on perçoit les limites de ce nouvel esclavagisme
Les risques que cette perspective faisait encourir au mouvement ouvrier ont été très tôt entrevus. Dès 1881, Paul Lafargue, le beau-fils de Marx, inquiet de voir ses contemporains se vouer corps et âme à leur labeur, publie un court pamphlet intitulé Le Droit à la paresse. Il y dénonce “la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales” et la folie d'un siècle qui, prétendant être celui du travail, est en fait “un siècle de la douleur, de la misère et de la corruption”, où l'on sacrifie “tout ce qui fait la vie belle et digne d'être vécue. (p. 50)
Une réalité qui se développe encore sous des dehors nouveaux et insidieux
Quelques voix minoritaires se sont dressées contre le discours dominant, et, parmi elles, celle de Simone Weil, qui a livré du travail taylorien l'une des critiques les plus puissantes. Nourrie de son expérience d'ouvrière de la grande industrie, la philosophe affirme que Taylor a “remplacé les fouets par les bureaux et les laboratoires, sous le couvert de science”. Les méthodes nouvelles prétendent viser le bien-être des travailleurs, en leur épargnant les gestes inutiles et les postures pénibles, mais elles constituent une forme accentuée de servitude, d'autant plus perverse qu'elle se prétend bienveillante. (p. 56-57)
Cette évolution va provoquer d'une part un changement des structures sociétales du monde du travail, et, d'autre part, une accentuation de la détérioration accrue du travail lui-même
L'économie s'est amplement tertiarisée et les activités industrielles, qui avaient structuré le monde du travail, ont cessé d'en être le cœur; les temps d'étude et de formation se sont allongés, retardant l'âge moyen d'entrée dans la vie active; l'espérance de vie en bonne santé a progressé continuellement, allongeant toujours plus, quoique inégalement selon les métiers exercés, la durée de la retraite; les femmes sont sorties de l'espace domestique où elles étaient confinées et sont massivement entrées dans les entreprises; les ouvriers ont accédé aux standards de consommation de la classe moyenne; les générations montantes, plus formées et plus mobiles, ont de plus en plus échappé aux conditions de leur milieu d'origine… Ces évolutions amples et profondes se sont accomplies graduellement, discrètement, et c'est seulement avec le recul que l'on en mesure la portée. La gauche, politique et syndicale, n'est jamais vraiment parvenue à les appréhender. Face à l'offensive néolibérale et aux crises successives, elle a concentré ses combats sur la défense de l'emploi, des statuts et des droits conquis par les générations précédentes, quand elle n'a pas simplement pris acte de l'étiolement de la classe ouvrière et réorienté ses priorités sur les classes moyennes, … Dans tous les cas, la question du contenu et du sens du travail est restée dans l'ombre. (pp. 64-65)
Non seulement la “société”, mais le travail lui-même semble être en cours de “perversion”
Au-delà de la gabegie qu'il engendre, ce nouveau management – qui n'a de nouveau que le nom, l'ensemble des méthodes n'étant que l'actualisation de bonnes vieilles méthodes tayloriennes – contribue à dégrader les conditions de travail. Dans un emploi normé par des procédures standardisées, dont tous les “temps morts” ont été éliminés, où l'activité se réduit à appliquer passivement des process sur lesquels on n'a aucune prise, en un temps rigoureusement mesuré sous le contrôle de supérieurs vérifiant le strict respect des normes de qualité à l'aide d'indicateurs chiffrés, le travail est aussi vidé de son sens que celui des ouvriers des chaînes de montage décrit par Simone Weil il y a près d'un siècle. Bien sûr, ces pratiques ne son pas devenues la norme, mais elles infusent un nombre croissant de métiers. Les sociétés d'encodage de données, les call centers, les bureaux de récupération de créances, les entreprises de conditionnement, les chaînes de restauration rapide, les services de nettoyage de bureaux ou de chambres d'hôtel… en sont quelques exemples. (pp. 84-85)
Il est donc urgent de rappeler ce qu'est le “vrai” travail, quelle est la valeur du “salariat” et comment le travail mérite une “gestion démocratique”!
Le “vrai” travail
Le travail décent ménage les corps, en les mettant à l'abri des accidents, des peines et des douleurs. Il respecte l'intégrité morale, l'estime de soi, en écartant le mépris et l'humiliation par les supérieurs hiérarchiques. Il est correctement rémunéré, et les prestations sociales qu'il finance protègent contre l'insécurité de l'existence. Il permet d'équilibrer les temps de travail et ceux de la vie personnelle. Il offre l'opportunité d'exprimer ses facultés, d'apprendre et de progresser. Il donne à chacun la chance de participer à l'organisation de ses tâches, en collaboration avec ses collègues. Les travailleurs qui se disent satisfaits ou très satisfaits de leur travail sont ceux qui rencontrent ces conditions. (p. 94)
Si le cœur du salariat est constitué de contrats stables assortis de droits étoffés, aux lisières se dessine un “second marché” beaucoup moins protégé. Or les effectifs y sont nombreux: en France, on estime qu'ils représentent environ 15% de la population active et près d'un emploi salarié sur cinq. Les travailleurs de cette “deuxième ligne” n'ont pas la visibilité qui fut celle des ouvriers d'usine dans la période fordiste, mais ils sont pourtant en train de devenir le cœur de la classe ouvrière. À lui seul le secteur de la logistique occupe en France près d'un million de salariés, dont 80% d'ouvriers, soit cinq fois plus que le secteur automobile… (p. 99)
La valeur du “salariat”
La puissance du salariat tient aussi au fait qu'il est devenu, à côté de l'impôt, un deuxième vecteur de socialisation de la richesse. Le modèle de protection sociale bâti en Europe continentale repose en effet sur les cotisations sociales prélevées de manière uniforme sur tous les salaires. Dans ce régime, une part de la prospérité collective est versée directement au travailleur sous forme de salaire mensuel, et une autre part lui est octroyée sous forme de prestations à portée universelle (allocations familiales, santé) ou de revenus de remplacement (chômage, retraite, maladie, handicap et invalidité). La citoyenneté sociale ancrée dans le salariat s'enrichit ainsi de droits qui traduisent en termes individuels le patrimoine collectif que constitue la Sécurité sociale. (pp. 106-107)
Si les pays scandinaves sont ceux où l'on note le plus de bien-être et de satisfaction dans le travail, une meilleure répartition des rôles entre hommes et femmes et des inégalités sociales ou ethniques moins marquées, ce n'est pas par hasard, mais parce que ces pays ont exprimé de longue date des préférences pour les politiques publiques universalistes, ancrées dans le salariat et portées par une gauche forte, dans sa composante politique autant que syndicale. (pp. 110-111)
Et l'inégalité salariale dans les entreprises ne peut être excessive
Il n'est pas rare aujourd'hui, dans les grands groupes, que cet écart soit de 1 à 300. Ou, en d'autres termes, que le CEO (chief executive officer) gagne en une journée plus que ce que ses employés gagnent en une année! Ces inégalités heurtent le sens commun. Des enquêtes européennes ont montré que les salariés jugent légitimes les différentiels de rémunération, mais qu'ils estiment qu'ils ne devraient pas dépasser un rapport de 1 à 5. (p. 112)
Gestion “démocratique” du travail
Dans le monde tel qu'il est, l'enjeu est au moins d'assurer que les relations hiérarchiques ne permettent pas de soustraire les questions d'organisation du travail aux salariés pour les confier aux seuls top managers. Simone Weil a exprimé cette exigence politique mieux que nul autre
Je ne puis accepter les formes de subordinations où l'intelligence, l'ingéniosité, la volonté, la conscience professionnelle n'ont à intervenir que dans l'élaboration des ordres par le chef, et où l'exécution exige seulement une soumission passive dans laquelle ni l'esprit ni le cœur n'ont part; de sorte que le subordonné joue presque le rôle d'une chose maniée par l'intelligence d'autrui. Telle était ma situation comme ouvrière. Au contraire, quand les ordres confèrent une responsabilité à celui qui les exécute, exigent de sa part les vertus de courage, de volonté, de conscience et d'intelligence qui définissent la valeur humaine, impliquent une certaine confiance mutuelle entre le chef et le subordonné, et ne comportent que dans une faible mesure un pouvoir arbitraire entre les mains du chef, la subordination est une chose belle et honorable (La condition ouvrière, p. 240). (pp. 131-132)
La preuve a été faite à grande échelle [à l'occasion de la crise du Covid et des problèmes d'emploi liés] de la puissance sociale transformatrice… d'une action dont le ressort est la qualité du travail. Dans le feu de l'action, on a vu apparaître des modalités inédites de “coopération conflictuelle”. …Le conflit est l'essence du politique, et l'entreprise, lieu de pouvoir, n'y fait pas exception. Il n'y a aucune raison de le déplorer. Le conflit a le mérite d'éroder le sentiment d'infériorité des subordonnés et de leur faire prendre conscience de leur pouvoir d'agir. […] le conflit fait aussi émerger des ponts de vue nouveaux et permet de sortir de la confrontation stérile de positions ankylosées. (pp. 133-134)
Le conflit social classique, centré sur les salaires, les horaires et les conditions de travail, se trouverait ainsi enrichi des conflits liés à l'organisation du travail, qui restent souvent inexprimés alors qu'ils sont en grande partie responsables d'un malaise diffus. Les médecins dialoguent avec des patients qui s'informent de plus en plus par eux-mêmes sur leurs pathologies, les enseignants apprennent à travailler avec des étudiants qui ont accès à des sources toujours plus riches de connaissances, les élus font face à des citoyens qui connaissent de mieux en mieux les procédures et les enjeux, il n'y a aucune raison que les syndicalistes ne tirent pas profit, eux aussi, du désir croissant des travailleurs de participer directement aux décisions qui les concernent. (pp. 135-136)
Comment conclure?
Libérer le travail des rapports de domination. Le marché n'est pas la seule référence. Le travail doit avoir du sens et être un lieu de socialisation.
Malgré les progrès technologiques continus, le travail humain demeure indispensable pour assurer notre subsistance, notre bien-être et notre cohésion sociale. Il est une contrainte, certes, une nécessité, mais il peut être le plus puissant vecteur d'expression de nos facultés et la plus fertile matrice de liens sociaux que l'humanité ait jamais inventée. Il ne s'agit pas tant de nous libérer du du travail que de libérer le travail des rapports de domination dont il est encore trop largement empreint. (p. 140)
Contester au marché le privilège qu'il revendique d'être la seule instance légitime de définition de ce qu'est l'emploi, des droits qu'il comporte et de la manière dont il est rémunéré, c'est prendre de front la forme actuelle de division du travail et les inégalités sociales, de genre et d'origine ethnique qui la fondent. C'est aussi mettre en cause le droit des détenteurs du capital de considérer la nature comme une ressource gratuite et exploitable sans limites. Prolonger ce mouvement de démarchandisation, c'est enfin lutter au quotidien pour une plus juste répartition du temps de travail, et pour le droit des producteurs de décider eux-mêmes de ce qu'il faut produire et comment il faut le produire. (p. 141)
L'enrichissement de nos aspirations dans la vie en général se traduit plutôt par une hausse de nos attentes à l'égard du travail lui-même. Nous n'attendons pas seulement de notre emploi qu'il nous garantisse un revenu et des droits, mais aussi la possibilité d'y exprimer nos facultés, d'y trouver du sens et de la reconnaissance, d'y tisser des liens sociaux. (p. 144)
Telles sont les principales conclusions de Paul Magnette.
Cette vision très “humaniste” du travail humain devrait, aujourd'hui, être soutenue et renforcée par tout ce qu'un Pierre Teilhard de Chardin propose sous la notion de l'effort et d'une vision de l'évolution globale du travail de la lourdeur industrielle vers la manipulation du laboratoire.
Et j'y verrais personnellement les
fondements d'une humanité renouvelée et créative sous l'aspect d'un homo
creativus (= homme de création) qui soulignerait et mettrait consciemment en
œuvre son rôle de co-créateur tel que dévolu à l'homo sapiens au-delà de l'homo
faber!