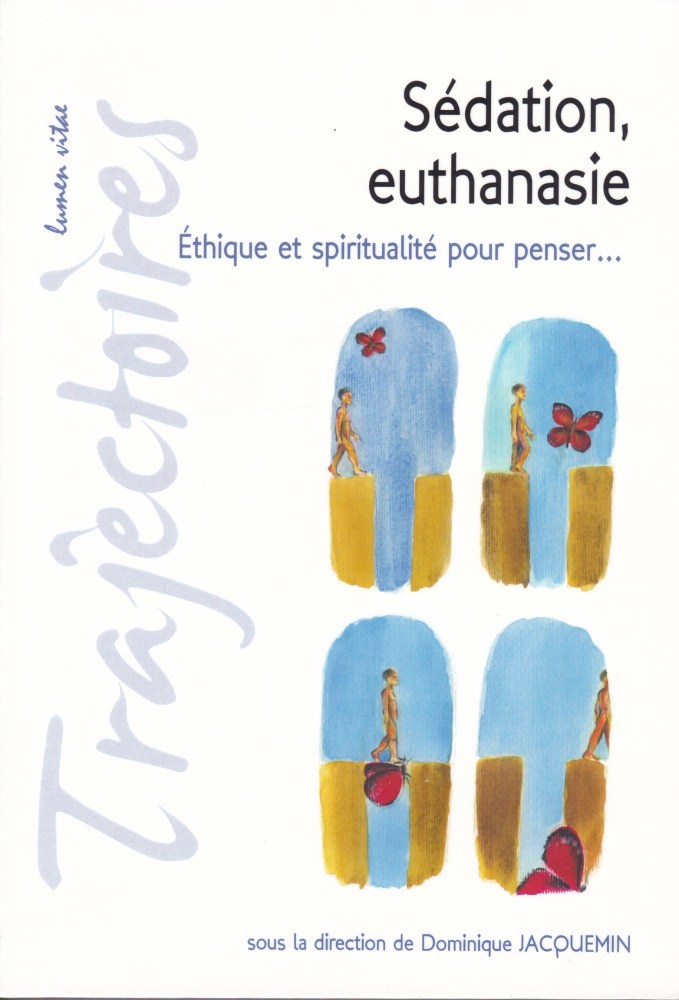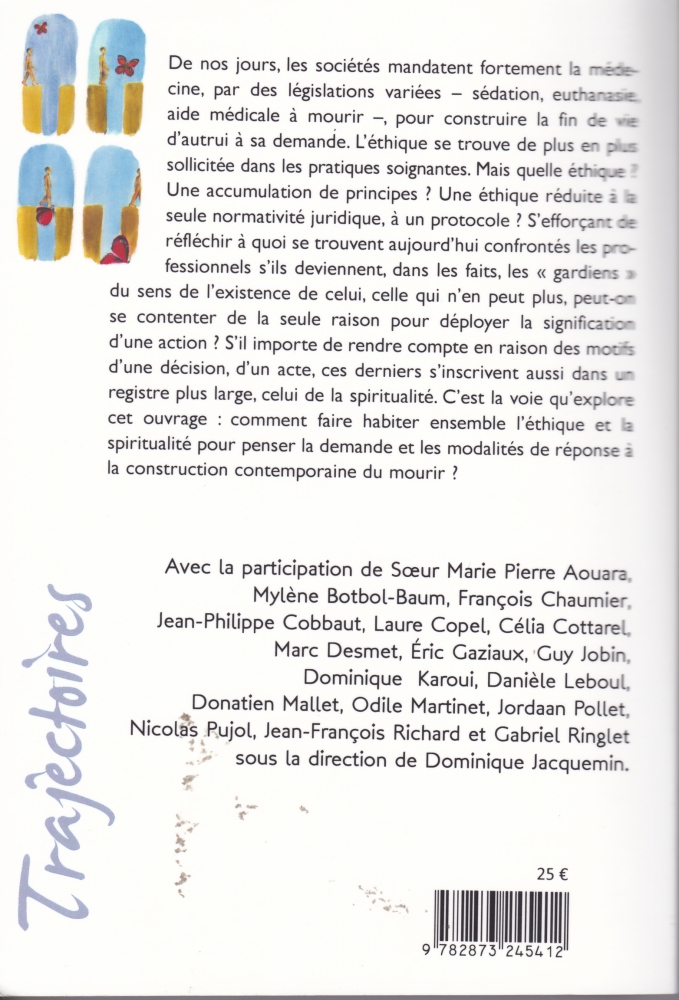Les pratiques de fin de vie
Mai 2021
Mesurer avec plus de nuances les différents enjeux sociétaux de la gestion de la fin de vie semble une nécessité dans la société vieillissante dans laquelle nous nous trouvons.
Dominique Jaquemin (Éd), Sédation, euthanasie. Éthique et spiritualité pour penser…, Éditions Jésuites, Namur, 2017, 306 pages, ISBN: 978-2-87324-541-2.
Quatorze Auteurs contribuent à cette publication née d'une journée de réflexion tenue le 11 mars 2017.
Comme le dit, en conclusion de sa contribution Pratique d'euthanasie: vers un juste milieu (pp. 259-289), Marc Desmet, jésuite et médecin à la Jessa Ziekenhuis de Hasselt (Belgique):
Je pourrais résumer ce qui précède en affirmant que les problèmes de la fin de vie exigent un équilibre difficile et la recherche courageuse d'un juste milieu entre une éthique des règles et une éthique des vertus. D'une part l'éthique des règles est “promue” par des lois politico-juridiques concernant le droit à la demande d'euthanasie, les droits du patient qui incluent le droit à l'information, au consentement, aux examens et aux traitements, les déclarations de volonté anticipées, et le droit aux soins palliatifs et les lois qui règlent leur subvention. L'éthique des règles se développe également à travers nos systèmes de management des institutions de soins. À un autre niveau encore, “la règle” s'impose par des positions “dogmatiques” dans les documents de l'Église officielle et de l'EAPC (European Association of Palliative Care). D'autre part, une éthique du soin et des vertus est répandue par la pratique du mouvement des soins palliatifs qui cultive certaines attitudes, des compétences au niveau du contrôle des symptômes, le concept de la “douleur totale”, l'approche interdisciplinaire et holiste, l'intégration des bénévoles, la culture de ne pas seulement supprimer, mais d'exprimer la souffrance, etc.
Le juste milieu entre les deux éthiques diffère de cas en cas, de médecin en médecin, de service en service, de pays en pays. Mais j'ose considérer la diversité par rapport à l'euthanasie comme quelque chose de sain, à condition qu'on arrive à un vrai dialogue sans trop de jeu caché – une condition pas acquise, mais à acquérir (p. 289).
L'ensemble des contributions mettent en évidence différents aspects de cette recherche d'équilibre dans l'intégration de l'euthanasie (ou de la sédation profonde) à une longue tradition “occidentale” (gréco-latine et judéo-chrétienne) d'interdiction absolue de limiter la durée de vie d'un autre être humain. Un contexte culturel qui a, paradoxalement et jusqu'à assez récemment dans l'histoire, accepté la peine de mort et exalté la mort héroïque (martyrs, héros militaires ou sauveteurs de différents types). Il est d'ailleurs étonnant que ces deux réalités historiques ne sont jamais évoquées dans ce recueil, fut-ce en toile de fonds idéologique, alors que l'on évoque ici ou là la toile de fonds “dogmatique” catholique qui dressait, jusqu'il y a peu, une interdiction absolue sur la liberté individuelle de mettre fin à sa vie (le “suicide” excluant même une sépulture “chrétienne”!) ‒ une toile de fonds qui exaltait la souffrance comme voie d'union spirituelle aux souffrances de l'exécution de Jésus de Nazareth par le pouvoir romain!
L'intérêt global de ces contributions est de ramener la “spiritualité” dans le champ de la santé, et, plus précisément, dans le champ de la santé gérée de plus en plus techniquement grâce aux progrès de la médecine.
Nicolas Pujol (Développer la recherche en soins palliatifs dans le champ “Spiritualité et Santé”, pp. 15-34) va donc tenter de définir la spiritualité dans ce champ: elle est de l'ordre de l'anthropologie; elle se distingue de la religion dans la mesure où “la religion serait une modalité culturellement normée de la spiritualité, mais elle ne serait pas la seule”; elle recouvre “un continuum de capacités allant de la recherche d'un sens à la vie (pôle existentiel) au fait de se sentir connecté à une dimension transcendante (pôle méta-religieux) qu'elle soit désignée en termes religieux ou séculiers” (p. 17)… avec un risque d'opposer spiritualité et religion (p. 23) ce qui ne serait pas correct: “la religion n'est pas uniquement affaire de rituel, d'appartenance à une communauté et de respect de dogmes, et la spiritualité n'est pas toujours synonyme de liberté individuelle, de paix et d'harmonie intérieure” (p. 23). Cette dimension spirituelle met en évidence, par rapport à une médecine “objectivante” (technique, rationnelle) “1. la singularité du sujet; 2. sa dimension existentielle (rapport à la finitude; gestion de la liberté; responsabilité; conscience de la solitude: personne ne peut rêver ou mourir à la place d'un autre; questionnement sur le sens de la vie); 3. sa relation à une transcendance” (p. 27).
Par rapport au droit, Mylène Botbol-Baum (De la volonté de mourir au droit de “bien” mourir, pp. 53-66) remarque que “Pour maintenir l'autonomie de droit face à la vulnérabilité de fait se sont développées les directives anticipées où un tiers est nommé pour préserver les volontés du sujet devenu incompétent. C'est à partir de ce changement de modèle de la relation médicale, du paternalisme au modèle délibératif, qui a intégré dans la pratique médicale une forme plus ou moins reconnaissable de l'éthique de la discussion prônée par Habermas, que la question de l'euthanasie active et volontaire a pris une dimension bio-politique” (pp.65-66). Ce qui amène à la question de savoir “comment le juridique peut-il intervenir de manière non paternaliste, mais néanmoins responsable?”… à quoi M. Botbol-Baum répond: “Au fond, ne doit-on pas repenser dans ce contexte les limites du droit subjectif et du droit public? Les controverses autour de l'euthanasie sont liées à la forte conviction que les décisions de fin de vie sont des questions de droit public à cause des conséquences sociales qui résulteraient de décisions non régulées. Le danger que ne peut tolérer un régime démocratique est le glissement de la tolérance de l'euthanasie volontaire à des pratiques hospitalières qui pourraient être qualifiées d'euthanasies sociales et qui seraient pourtant difficilement distinguables d'euthanasies volontaires si un processus de traçabilité de la volonté réitérée du patient de ne pas survivre à tout prix n'est pas mis en place” (p. 70). Et de conclure: “La question de l'euthanasie nous engage à radicalement repenser le rôle du droit public face aux conflits de droits subjectifs” (p. 76).
Donatien Mallet et François Chaumier (Éléments contextuels relatifs à la délibération sur les orientations de traitement pour les personnes cérébro-lésées, pp. 89-125) constatent avec satisfaction qu'une large réflexion est en cours (on songe particulièrement aux cas de plus en plus fréquents de démence sénile ou d'Alzeimer): “Sur le plan éthique, une importante réflexion est menée relative à la conception et à la valeur de la vie, au statut de la personne, à son lien ou non avec une conscience, à la classification de la nutrition artificielle en tant que soin ou traitement, au cadre de la délibération, à la place des proches, à la solidarité nationale vis-à-vis des plus vulnérables” (p.92).
Une étude de terrain dans le domaine de la fin de vie pour les enfants, offre un échantillon très complet des principaux acteurs qui doivent intervenir et des problèmes éthiques et relationnels que cela pose. Jordan Pollet (Le vécu infirmier dans le cadre des décisions médicales de fin de vie en pédiatrie, pp. 127-180) conclut:
Les infirmiers jouent un rôle crucial dans l'organisation du soin aux patients en situation de fin de vie; comme, par exemple, dans l'évaluation des symptômes, dans la gestion de la douleur et du confort, et dans le soutien et l'accompagnement quotidiens des parents et des familles. Les infirmiers représentent le plus grand groupe de professionnels prenant soin des patients en fin de vie. La prise en compte de l'expérience infirmière dans les discussions de fin de vie est dès lors essentielle. Une meilleure compréhension du rôle et du vécu infirmier œuvrant auprès des patients qui requièrent une décision médicale de fin de vie permet de promouvoir l'optimalisation des soins infirmiers auprès de cette population (p. 179).
Une équipe de plusieurs auteurs lié au Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon (Paris), réfléchit à l'accompagnement dans le cas de sédation profonde (pp. 183-198) dans le contexte de la loi française Claeys-Leonetti (2005 et 2016).
Ils se demandent notamment
s'il ne faudrait pas remplacer le mot ‘sédation’ par l'expression ‘traitement à visée sédative’, la précision de la visée dit d'emblée quelle en est l'intention”… mais ils font aussi remarquer que “les expressions ‘fin de vie’, ‘phase terminale’, ‘agonie’, ‘pronostic réservé à court terme‘, ‘phase palliative exclusive’, recouvrent pour chacun (soignant, patient, proche, mais aussi pour les médias) des significations différentes et mériteraient d'être clairement définies sur le plan sémantique (p. 186).
Ces distinctions visent toutes à une meilleure prise en compte de la personne:
Dans l'accompagnement, il ne s'agit pas de déloger la personne de ce qu'elle dit, mais de la reconnaître dans ce qu'elle exprime. En tant que soignant, pouvoir entendre que pour le patient il n'est pas digne de vivre sans le juger ni chercher à le convaincre du contraire et continuer à l'écouter jusqu'au bout, c'est prendre soin de son humanité en le reconnaissant comme un semblable capable d'énoncer quelque chose de ce qu'il vit (p. 194).
Et de conclure:
La pratique de la sédation profonde telle qu'elle est définie dans la loi constitue un “ soin ” dans la mesure où c'est une réponse réfléchie et adaptée à la personne reconnue comme sujet vivant et désirant (p. 198).
Sur la scène française, voici comment un jury citoyen a donné son avis sur les suites à donner à la loi Claeys-Leonetti en date du 14 décembre 2013:
Aujourd'hui en France, on meurt le plus souvent à l'hôpital, en maison de retraite, seul, parfois abandonné, en tout cas éloigné de son environnement quotidien et familial. Cette évolution des conditions de la fin de vie génère de l'angoisse pour les personnes concernées d'autant plus forte que les écoles de pensée et les courants religieux qui proposaient précédemment des “ recettes ” pour s'habituer à la mort ont perdu de l'influence dans la société française, du moins n'ont plus l'exclusivité des réponses (p. 222).
Jean-François Richard (La sédation profonde et continue: une illusion au cœur du tragique de l'existence, pp. 219-236) montre les limites de cette pratique:
Pour le groupe de travail de la SFAP, “la sédation est la recherche, par des moyens médicamenteux, d'une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu'à la perte de conscience. Son but est de diminuer ou de faire disparaître la perception d'une situation vécue comme insupportable par le patient, alors que tous les moyens disponibles et adaptés à cette situation ont pu lui être proposés et/ou mis en œuvre sans permettre d'obtenir le soulagement escompté.”
Pour autant cette technique de la sédation (en note: Il serait plus exact de parler de sédations [au pluriel] car les modalités pratiques de cette technique sont multiples) n'est pas sans poser de questions. Sa mise en œuvre pratique n'est pas simple, car le principal produit utilisé – le midazolam – présente une très grande variété pharmacodynamique d'un patient à l'autre, ce qui nécessite des ajustements de doses itératifs. Sur un plan éthique, la sédation de par la disparition de la communication et éventuellement de la conscience qu'elle impose au malade, fait entrer l'équipe de soin et les proches dans un temps auquel il peut être particulièrement difficile de donner du sens notamment lorsqu'il “dure”. Et si cette sédation est maintenue jusqu'au décès, les équipes subissent une “ double peine ”, un éprouvé de transgression se surajoutant à un constat d'échec de leur pratique clinique (pp. 229-230).
Et il précise:
Ce constat clinique d'échec de la sédation, malgré la croyance collective qui a conduit à la mettre en place, nous fait évoquer une “illusion” alors même que l'ensemble de la situation est tragique. Mais quelle serait alors cette illusion? Ce serait de croire que la médecine (en reconnaissant sa puissance techno-scientifique) associée au droit (reconnaissance de la puissance de la démocratie) et à la légitimité de la demande du malade (reconnaissance de la puissance de son autodétermination) pourrait venir à bout du tragique de l'existence. Il s'agirait d'une triple reconnaissance, érigée en “valeur absolue” qui serait comprise comme “toute-puissante”. Telle serait l'illusion (p. 233).
Dominique Jacquemin (Souffrances, sédation et soins palliatifs. Quelles enjeux éthiques pour la clinique et la société?, pp. 237-255), rappelle la position d'un Groupe de Travail de la Conférence des Évêques de France parue en 2015:
Aujourd'hui, la question du sens ou de l'absence de sens de ces derniers moments de la vie ne peut que nous interpeller et plus particulièrement encore quand se pose la question de la sédation profonde en phase terminale. Soyons clair, il ne s'agit pas de réintroduire une notion de “ souffrance rédemptrice ” ou de dire “ qu'il est bon de souffrir ”. Non, toute souffrance doit être impérativement rencontrée et traitée. Cependant, abraser ce temps mystérieux de la fin de vie, où douleur et souffrance peuvent être si intimement mêlées, n'est-ce pas aussi prendre le risque de lui enlever toute signification possible par une seule réponse technique à la souffrance – le médicament – en s'illusionnant sur la réponse donnée au corps? En calmant la manifestation douloureuse du corps, en réduisant l'expression – certes inconfortable – de la souffrance psychique – nous pensons ici particulièrement à la confusion ‒, est-il réellement assuré que nous prenions soin du sujet souffrant? (p. 244-245).
Il propose ensuite sa propre vision de l'accompagnement d'une sédation profonde:
Comme le développe à merveille D. Mallet, ce temps de l'agonie sédatée à la demande du patient sollicite une nouvelle créativité en termes d'accompagnement. Tout d'abord, l'entrée en sédation, comme ultime moment de communication possible avec l'entourage, se devra d'être pensée un peu à l'image d'un décès anticipé, ce qui peut ne pas être simple pour une famille. Que devra-t-il être dit pour qu'il n'existe aucun regret de non-dit à la sortie du patient de l'horizon de la rencontre et de la communication? Comme y invitent certains auteurs (notamment G. Ringlet), une dimension ritualisée – pensée ici comme célébration conjointe d'un sens – pourrait être envisagée. Mais qui, en pareils instants, en portera la mise en œuvre avec de légitimes compétences? Est-ce à la médecine de célébrer le sens de son action, traversée ici par l'échec des tentatives précédentes à rencontrer le patient dans sa souffrance? À titre personnel nous restons en interrogation sur cette importante question tout en ayant la conviction que ce type de pratique doit être pensé afin d'être proposé au patient. Ces mots et gestes échangés pourront concourir, nous semble-t-il, à une dimension mémorielle de l'accompagnement à venir: ce que nous avons fait, pourquoi l'avons-nous fait? (p. 253).
Quant aux propos de Marc Desmet, s.j. (Pratique d'euthanasie: vers un juste milieu? pp. 259-289), il montre clairement la situation de ces problématiques en Belgique (même s'il dit limiter la base de ses observations majoritairement à la Flandre), notamment:
Cela veut dire que le problème de l'euthanasie se situe dans un contexte de médicalisation forte et croissante de la mort. Actuellement en Belgique, une mort sur deux est influencée par une décision médicale. Cela me semble important pour toute réflexion concernant la fin de vie et la question de l'euthanasie. (p. 264).
Et il témoigne de sa propre pratique:
Le but de mon accompagnement d'une demande d'euthanasie n'est pas de viser à ce que le malade ne la demande plus même si je préfère personnellement qu'il n'y ait pas d'euthanasie, et ce, même si je fais tout mon possible avec mon équipe en vue d'améliorer les soins pour ce patient. Néanmoins, mon premier but est d'aider le malade – dans son contexte – à voir plus clairement ce qu'il veut vraiment. Sa volonté est-elle un authentique acte libre et le fruit d'un discernement? Cela implique un accompagnement du patient, mais aussi des proches et de l'équipe. (p.269).
Et il revient alors sur l'aspect “spirituel” de ces situations de fin de vie médicalisées:
Cela nous renvoie aux données “spirituelles” dans une décision. À vrai dire, souvent ce qui est décisif dans les demandes d'euthanasie est de l'ordre de la souffrance spirituelle comme la dépendance de l'aide des autres, se sentir un poids pour les autres, devoir quitter une personne aimée, le manque de perspective, une expérience profonde de non-sens. Mais le spirituel ne joue pas seulement un rôle négatif. Le bon décideur va aussi être sensible à la présence ou à l'absence de sérénité, de calme intérieur chez le malade – et si possible chez les personnes de l'entourage et de l'équipe – dans un processus d'élucidation d'une demande reconnue. Dans ce processus, on peut observer l'effet de certains gestes ou paroles: quel est l'effet de laisser formuler une demande écrite, c'est-à-dire l'acte dans lequel le malade écrit formellement qu'il demande actuellement l'euthanasie? Ce papier n'oblige en rien le médecin, mais on constate souvent que le malade devient plus patient, plus gentil, plus coopérant puisqu'il se sent pris au sérieux. Il dort mieux. On peut observer les mêmes effets après l'information générale que l'euthanasie est possible dans l'institution sans pour autant avoir déjà décidé de l'issue du processus décisionnel. Ou comment est reçue la possibilité de la sédation chez un patient en phase terminale comme alternative quand des proches s'opposent fortement à l'euthanasie (pp. 277-278).
On retrouve encore une autre expression de sa pratique quand il dit:
Beaucoup regardent la Belgique avec énormément de suspicion par rapport à la fin de vie. Je comprends cette méfiance. Parfois elle est due au manque d'information, par exemple à propos de notre réseau de soins palliatifs qui est parmi les meilleurs au monde. Parfois la méfiance est plus fondée. Mais en tant que médecin belge, je me vois placé devant la situation concrète d'une loi qui permet ce qu'une majorité de la population veut clairement. En tant que médecin, j'ai à prendre au sérieux la demande d'euthanasie du patient et j'ai à décider de ma position par rapport à une pratique éventuelle. En tant que catholique, je dois prendre au sérieux d'une part l'interdit général de tuer et, d'autre part, la même tradition qui prône un grand respect pour la conscience individuelle du malade et de moi-même. Je considère le christianisme comme la religion de la liberté, malgré les apparences. Difficile liberté dans la suite de Jésus de Nazareth. Ainsi j'ai décidé de ne pas pratiquer l'euthanasie, mais de l'accompagner jusqu'à la fin. À l'intérieur du non-permis, je discerne encore beaucoup d'éthique. Si on fait l'euthanasie, il faut la faire bien. Est-ce de la perversion? Peut-être! Pour ma part, c'est ma façon de ne pas abandonner le malade qui demande l'euthanasie et de chercher la nuance qui honore la complexité de la vie et de la mort. L'euthanasie n'est pas un meurtre, mais continue à être la transgression d'un interdit qui fonde une société. La façon de transgresser reste néanmoins une question éthique: je distingue, comme dit précédemment, des euthanasies “chaudes” et des euthanasies “froides”. Et, en même temps, j'essaie de discerne les risques et les défis sous-jacents qui ne sont pas des moindres. (pp. 284-285)
Une position qu'il faut compléter par l'avis suivant:
À mon avis, le plus grand problème éthique en Belgique, d'un point de vue statistique, n'est pas le problème de l'euthanasie, mais bien le problème du manque de soignants dans les services des hôpitaux et surtout dans les maisons de soin pour des personnes âgées. Le soignant ne peut pas aider comme il voudrait le faire, ou le cadre de soin requis pour telle pathologie manque. Ce soignant surchargé est en plus confronté à des demandes d'euthanasie de plus en plus complexes (p.286).
Mais le constat va plus loin aujourd'hui:
J'observe en effet une évolution vers des euthanasies qui prennent, de mon point de vue, le caractère d'un suicide assisté. Ici je ne parle pas de l'aide au suicide au sens juridique et technique (la potion lithique et pas la piqûre), mais plutôt au sens moral. Je pointe vers des euthanasies où parfois la situation médicale sans issue est moins claire, comme dans les cas neuropsychiatriques: une dépression peut constituer une souffrance subjective importante, mais quand une dépression est-elle vraiment incurable médicalement parlant? Ceci est encore plus vrai dans les fatigues de vie. Le fait qu'il s'agit souvent dans ces cas de personnes qui pourraient encore vivre de longues années augmente aussi le caractère de suicide assisté. Cette évolution pourrait conduire au simple droit à l'aide au suicide, donc de personnes sans problème médical ni souffrance intolérable. Il suffirait de considérer que sa vie est “achevée”. Aux Pays-Bas, on parle en effet dans ces cas de “la vie achevée” (het voltooide leven) bien qu'une telle proposition de loi y ait été rejetée en 2013. Cette évolution nous conduit au paradoxe d'une société qui cherche la prévention du suicide et qui, en même temps, organise l'aide au suicide” (pp. 287-288).
C'est là qu'il faut attacher la recherche d'un “juste milieu” évoquée dans le début du présent compte rendu! Et tous ces apports considérables se concluent par celui de Gabriel Ringlet (L'accompagnement rituel … jusqu'à l'euthanasie, pp. 291-296).
Célébrer, ce n'est pas fuir la vie ordinaire, c'est s'en emparer et la soulever pour lui offrir plus de légèreté. Et lorsqu'il s'agit de souffrance et de fin de vie en particulier, je me refuse à séparer trois mots qui se donnent la main: soigner, accompagner et célébrer. Soigner, évidemment, car il reste encore beaucoup à faire du côté médical dans la lutte contre la souffrance. Accompagner, élargir le soin jusqu'à sa dimension relationnelle. Et célébrer, c'est-à-dire élever, agrandir, élargir, porter plus loin ce qui se joue là de si exigeant et difficile (p.291).
Voir la proposition de ritualisation que le signataire du présent compte rendu décrit dans le Billet qui ouvre le numéro d'Interface_2020/21-Avril2021!